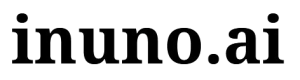l’essentiel
Le capitaine du Stade Toulousain et du XV de France se retrouve inapte à exercer son métier pour de longues semaines après sa grave blessure à un genou survenue le 8 mars dernier en Irlande lors du Tournoi des 6 Nations. Un accident du travail.
Qui paie les joueurs durant leur période de convalescence et dans quelles proportions ? La blessure étant considérée comme un accident du travail, plusieurs mécanismes leur permettent de conserver l’intégralité de leur salaire durant ce laps de temps plus ou moins long.
Et disons-le tout de suite pour mettre fin au fantasme : la Sécurité sociale n’est pas la seule à prendre le relais des clubs. Elle répercute même le coût que cela représente en augmentant le taux de cotisation des employeurs les années suivantes.
Comme pour tout salarié en arrêt, elle joue évidemment son rôle, mais jusqu’à un certain montant. 11 775 € exactement, ce qui correspond à trois fois le plafond de base (3 925 €). Le versement des indemnités pouvant souvent prendre plusieurs mois, surtout si le dossier est mal “emmanché” (tous les 15 jours quand tout se passe normalement, ce qui plus est rare), les clubs réalisent l’avance en pratiquant la subrogation dans le droit à perception.
Alors bien sûr, on est encore loin des montants que perçoivent une grande partie des joueurs de Top 14, avec un salaire mensuel moyen estimé à 20 000 €. En ce sens, la Convention collective du rugby professionnel (CCRP) prévoit qu’ils puissent être couverts au minimum jusqu’à cinq plafonds de la Sécurité sociale, soit jusqu’à 19 625 €, via un système de prévoyance, dont la cotisation ne peut dépasser 3,6 % du salaire selon la répartition suivante : 42,5 % payés par le salarié, 57,5 % par l’employeur.
Charge ensuite aux clubs de négocier des taux plus intéressants avec leur assureur mais aussi de mettre en place des outils permettant à leurs joueurs d’être couverts au-delà.
Alors que certains peuvent aller jusqu’à 12 plafonds de la Sécurité sociale (soit 47 100 €) dans l’offre de “surcouverture” qu’ils proposent – son coût demeure à l’entière charge des intéressés –, d’autres, beaucoup plus rares, vont même plus loin en n’appliquant pas de plafond. Un processus collectif qui offre l’avantage aux plus âgés, potentiellement sujets à un plus grand nombre de blessures, d’être en mesure de s’assurer quand la démarche individuelle pourrait s’avérer plus périlleuse, avec en prime des exclusions liées aux antécédents.
Un dossier épineux pour la FFR
Seulement, une donnée vient complexifier l’équation. Car ce schéma ne correspond qu’aux blessures survenues dans le cadre du club et non dans celui des équipes nationales. Logiquement, c’est la prévoyance souscrite par chaque fédération qui se substitue à celle des clubs lorsque les accidents de jeu ont eu lieu durant les matchs internationaux.
Et selon nos informations, il y a actuellement un vrai chantier ouvert dans le rugby français pour les Bleus puisque la FFR, confrontée à une sérieuse problématique financière, s’est récemment fait “plaquer” par la GMF, son assureur historique, qui offrait un contrat mieux-disant sur certains critères que le minimum imposé par World Rugby.
Et a donc subi, pour la saison en cours, la négociation avec HDI Global SE, son nouveau partenaire dont le contrat respecte certes le cadre légal mais n’atteint le niveau du précédent. Ce qui fait forcément, en attendant la renégociation à venir, grincer des dents auprès des clubs pourvoyeurs d’internationaux…