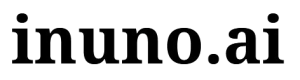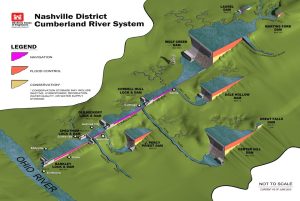l’essentiel
L’affaire du collège-lycée Notre-Dame de Bétharram, où plusieurs accusations de violences sexuelles ont émergé, jette la lumière sur les mécanismes de contrôle des établissements privés sous contrat. Comment s’assure-t-on qu’ils respectent leurs obligations ? Qui surveille réellement ce qu’il s’y passe ? La Dépêche du Midi fait le point.
La polémique ne faiblit pas. Alors que le parquet de Pau enquête sur plus d’une centaine de plaintes déposées pour agression sexuelle, viol ou encore violences physiques au sein de l’établissement privé Notre-Dame de Bétharram, l’affaire relance la polémique sur le contrôle des collèges et lycées privés. Ces établissements, bien que financés en partie par l’État, bénéficient d’une importante autonomie.
Une histoire marquée par des tensions
La question de l’enseignement privé en France est ancienne et remonte à 1806, lorsque Napoléon Ier établit le monopole d’État sur l’éducation avec la création de l’Université impériale. En 1959, la loi Debré instaure les contrats entre l’État et les établissements privés, permettant à ces derniers de recevoir des financements publics tout en conservant leur caractère propre.
Cette contractualisation vise à intégrer les écoles privées dans le service public de l’éducation, tout en respectant la liberté d’enseignement.
Cependant, cette cohabitation n’a pas été sans heurts. En 1984, le projet de loi Savary, du nom du ministre de l’Éducation nationale, qui envisageait d’intégrer les établissements privés au sein d’un “grand service public unifié et laïque de l’éducation nationale”, suscite une vive opposition. Le 24 juin 1984, une manifestation massive à Paris rassemble des centaines de milliers de défenseurs de l’école privée, dont Simone Veil ou Valéry Giscard d’Estaing, conduisant finalement au retrait du projet de loi et à la démission du Premier ministre de l’époque, Pierre Mauroy.
Des obligations proches des établissements publics
Depuis, aucun gouvernement n’a osé s’attaquer à l’enseignement privé. Aujourd’hui, ces établissements, au nombre de 7500 selon la Cour des comptes, sont divisés entre les institutions sous contrat et celles hors contrat. Les premières sont tenues de suivre les programmes officiels de l’Éducation nationale et de respecter les principes fondamentaux tels que la neutralité et l’accueil de tous les élèves, sans distinction. En contrepartie, l’État rémunère les enseignants et participe au financement de l’établissement. Les établissements hors contrat en revanche ne bénéficient d’aucun financement de l’État mais n’ont aucune obligation de suivre les programmes officiels. Aujourd’hui, environ 17 % des élèves français sont scolarisés dans l’enseignement privé, dont 97 % dans des établissements sous contrat.
Des mécanismes de contrôle insuffisants
Tous les établissements privés, quels qu’ils soient, sont soumis au contrôle de l’État, notamment par le biais d’inspections académiques qui évaluent la qualité de l’enseignement et le respect des programmes. Néanmoins, la gestion interne, comme les ressources humaines ou encore la vie scolaire, reste largement autonome et aux mains des chefs d’établissement. La loi du 15 mars 2004, portant sur l’interdiction des signes religieux dans les établissements scolaires, n’est par exemple pas appliquée au sein des établissements privés, même sous contrat.
Des sanctions régulières
L’État tente pourtant de multiplier les contrôles sur les établissements pour éviter d’éventuelles dérives. En mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes avait notamment ordonné la fermeture du collège privé Avicenne à Nice, invoquant des “irrégularités financières”. Décision finalement annulée par la justice, mais l’établissement a depuis perdu sa contractualisation avec l’État. Quelques années plus tôt, c’est le lycée Gerson, à Paris, qui avait été accusé de dérives intégristes et sectaires.
Mais ces contrôles symboliques restent bien souvent insuffisants. Dans un rapport rendu en avril 2024, les députés Paul Vannier et Christophe Weissberg mettent en évidence les défaillances dans le contrôle des financements publics accordés aux établissements privés sous contrat. Selon le rapport, “il faudrait 1500 ans pour contrôler tous les établissements privés. Pourtant, ceux-ci sont obligatoires”.
La ministre de l’Éducation nationale, Elisabeth Borne, a annoncé demander au rectorat de Bordeaux “d’avancer ses opérations de contrôle pour disposer d’éléments sur le fonctionnement actuel de cet établissement.”